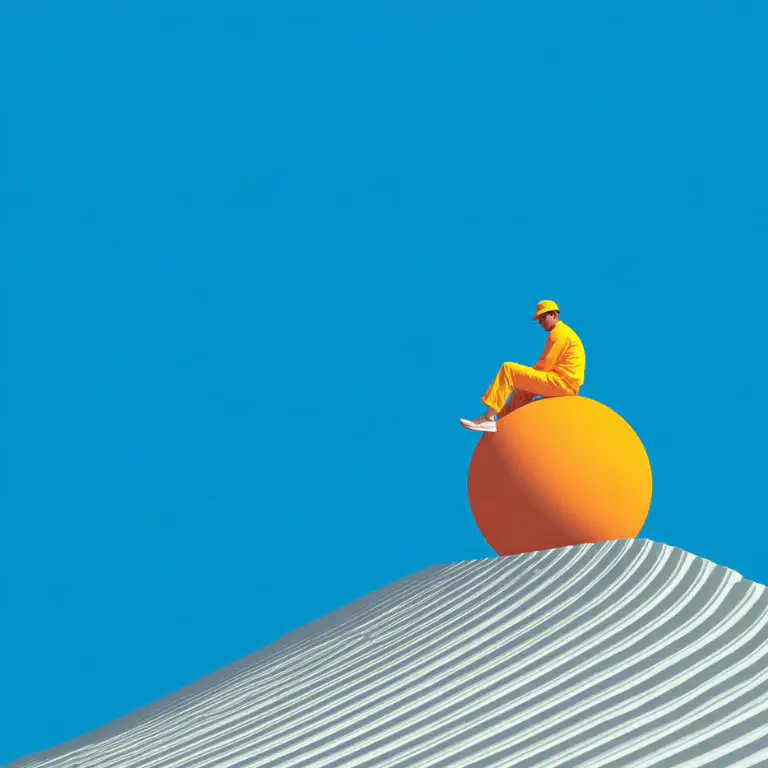Pourquoi une gestion active du changement est-elle importante ? #
Les entreprises sont exposées à des conditions environnementales dynamiques et doivent constamment adapter leurs processus et structures afin de maintenir leur compétitivité et leur capacité d’innovation. Que vous souhaitiez par exemple introduire de nouvelles technologies telles que l’IA et les solutions sans code, développer de nouveaux processus pour répondre aux obligations légales ou préparer votre expansion sur de nouveaux marchés, une chose est toujours au centre de vos préoccupations : les personnes - vos employés et vos clients. Une gestion active du changement est essentielle pour prendre en compte les objections et les préoccupations, impliquer toutes les parties prenantes et planifier et mettre en œuvre des mesures de manière transparente et sans surcharger personne. Ainsi, vous vous assurez que le changement est vécu. Dans le cas contraire, vous risquez de démotiver vos collaborateurs et peut-être même de perdre des clients au profit de concurrents .
Qu’est-ce que la gestion du changement ? #
Avant d’entrer plus profondément dans le sujet, clarifions encore une fois le terme. En effet, il est aujourd’hui sur toutes les lèvres (ou presque). Cependant, comme pour de nombreux autres mots à la mode, il est souvent difficile de comprendre ce qu’il signifie exactement. Une définition de la gestion du changement est donc recommandée.

La gestion du changement désigne la mise en œuvre de toutes les stratégies, processus et mesures visant à organiser de manière ciblée et systématique des changements profonds dans des services ou des organisations entières. Il peut s’agir de changements organisationnels, technologiques ou culturels, ces derniers étant les plus exigeants. L’essentiel est qu’il s’agisse d’un processus de changement complexe et profond pour l’organisation concernée. Si seules quelques procédures sont optimisées, on ne parle pas de gestion du changement.
La gestion du changement et la transformation sont-elles la même chose ? #
En bref : non, les deux termes sont étroitement liés, mais pas synonymes. Le terme “transformation” décrit certes aussi des changements fondamentaux, généralement à grande échelle - par exemple la réorientation complète d’un modèle d’entreprise ou la transformation numérique d’une entreprise. La gestion du changement, en revanche, se réfère à la planification et à l’accompagnement structurés de ce changement et pose ainsi les jalons d’un succès durable. Pour rester dans l’exemple de la numérisation : L’expression “transformation numérique” indique plutôt l’objectif stratégique, alors que la gestion et la mise en œuvre concrètes relèvent de la gestion du changement.

Quel est le rôle des employés dans la gestion du changement ? #
Comme nous l’avons déjà mentionné, un processus de gestion du changement réussi dépend de l’implication active de vos employés. En effet, ce sont eux qui, en fin de compte, doivent appliquer de nouveaux processus, modifier leurs méthodes de travail et vivre le changement au quotidien. Les émotions jouent un rôle important dans la gestion du changement. Si les craintes, les doutes et les incertitudes ne sont pas pris au sérieux à un stade précoce, des résistances et des frustrations apparaissent rapidement, ce que vous souhaitez éviter à tout prix. La transparence, une communication régulière et, le cas échéant, des possibilités de formation continue sont les bases absolues pour impliquer les collaborateurs en tant que partenaires et contributeurs. Les réunions d’équipe, les ateliers et les entretiens individuels permettent d’apaiser les inquiétudes et de lever les blocages.
Le modèle en 7 phases de Streich #
Dans ce contexte, les responsables du changement doivent régulièrement se remémorer le modèle en 7 phases de Streich. Richard Streich et Sonja Sackmann ont développé ce modèle pour décrire comment les gens vivent et réagissent émotionnellement à des changements profonds :
-
1. Phase : choc
-
2. Phase : Négation
-
3. Phase : Reconnaissance
-
4. Phase : acceptation
-
5. Phase : Essayer
-
6. Phase : réalisation
-
7. Phase : intégration
Accompagner les employés tout au long des deux premières phases et faire en sorte qu’elles soient aussi courtes que possible est une tâche essentielle pour les dirigeants et les gestionnaires du changement dans les processus de changement.

Quels sont les modèles de gestion du changement disponibles ? #
Comme dans d’autres domaines, différents modèles de gestion du changement sont à votre disposition. Ils offrent des réponses apparemment simples et promettent, grâce à une structure claire, de rendre votre planification de la gestion du changement concrète et contrôlable. Cependant, aucun de ces modèles ne répond parfaitement à la dynamique complexe des processus de gestion du changement. Examinons ensemble de manière critique les quatre modèles les plus fréquemment cités dans les guides de gestion du changement :
-
le modèle en 3 phases de Lewin
-
le modèle en 8 étapes de Kotter
-
le modèle en 5 phases selon Kruger
-
le modèle ADKAR
Le modèle en 3 phases de Lewin #
Ce modèle du psychosociologue allemand Kurt Lewin est l’un des plus anciens modèles de gestion du changement. Il a été publié pour la première fois en 1947 et s’intéressait à l’origine uniquement aux processus de changement culturel. Lewin, qui vivait en exil aux États-Unis, a formulé trois phases dans la gestion du changement :
-
Unfreeze : le statu quo existant est dégelé afin de générer une volonté de changement.
-
Changement : le processus de changement est mis en œuvre.
-
Refreeze : les nouveaux processus sont intériorisés et stabilisés.
Inconvénients du modèle en 3 phases.
Au cœur du modèle de Lewin se trouve la nécessité de préparer consciemment les changements, de les ancrer et de les stabiliser durablement grâce à une planification réfléchie de la gestion du changement. Ce qui semble logique au premier abord s’avère être une approche dépassée lorsqu’on y regarde de plus près :
-
Figer un état organisationnel ou un processus n’est guère envisageable dans les entreprises modernes et agiles.
-
La compréhension mécaniste de Lewin des structures et des organisations ne correspond plus à la réalité.
Le modèle en 8 étapes de Kotter #
Un autre classique parmi les méthodes de gestion du changement est le modèle en 8 étapes de John Kotter. Le modèle de Kotter est celui qui peut être le plus facilement compris comme un concept de gestion du changement, car il formule un processus clair plutôt que des phases de gestion du changement plus abstraites :
- créer l’urgence
- Créer une équipe de direction
- Développer la vision
- Communiquer la vision
- Éliminer les obstacles
- Obtenir des résultats à court terme
- Poursuivre le changement
- Ancrer le changement
Inconvénients du modèle en 8 étapes
Le modèle de Kotter montre également qu’une transformation n’est possible que si l’urgence est comprise et qu’il existe une vision claire dès le départ. Dans l’ensemble, Kotter aborde le sujet de manière beaucoup plus pratique et granulaire que Lewin ou Krüger. Cependant, il y a aussi des critiques :
-
Les mesures de gestion du changement ne se déroulent généralement pas de manière linéaire, mais souvent en parallèle.
-
Les étapes sept et huit de Kotter, la mise en œuvre proprement dite, sont beaucoup plus complexes et coûteuses que ne le suggère son modèle.
-
Kotter considère que la gestion du changement est dictée et exécutée par la direction et néglige le rôle actif des employés.
-
Il ne précise pas comment sont gérés les retours en arrière.
Modèle en 5 phases selon Kruger #
Ce modèle de l’économiste Wilfried Krüger identifie cinq phases successives dans la gestion du changement :
- Initialisation : identifier le besoin de changement et formuler les premiers objectifs.
- Conception : concevoir des solutions, définir des mesures et des équipes de projet.
- Mobilisation : impliquer les collaborateurs, susciter l’adhésion et encourager la motivation.
- Mise en œuvre : mettre en œuvre les mesures prévues de manière opérationnelle.
- Pérennisation : Assurer les succès, définir de nouvelles normes et les contrôler.
Les troisième et quatrième phases sont des étapes particulièrement critiques dans la gestion du changement, car elles permettent de réduire les résistances potentielles et de créer une disposition positive au changement.
Inconvénients du modèle en 5 phases.
Le modèle de Krüger mentionne certes les phases importantes de la gestion du changement, mais, tout comme Kotter, il part d’un concept de gestion du changement linéaire et rigide. La manière exacte dont la mise en œuvre doit fonctionner reste plutôt vague. De plus, Krüger s’appuie sur des incitations spéciales pour encourager les collaborateurs à s’engager dans le changement, plutôt que de les impliquer et de les convaincre de son utilité.
Modèle ADKAR #
Le modèle ADKAR a été développé par le gestionnaire du changement Jeff Hiatt et se base sur l’analyse des processus de changement de quelque 700 organisations. Il est considéré comme particulièrement orienté vers la pratique et se concentre sur les processus de changement individuels des employés. ADKAR est un acronyme pour Awareness (conscience), Desire (désir), Knowledge (connaissance), Ability (capacité) et Reinforcement (renforcement). Tout comme le modèle en 5 phases, l’approche de Hiatt vise à créer une prise de conscience de la nécessité du changement et à soutenir sa mise en œuvre durable.
Inconvénients du modèle ADKAR.
Le modèle de Hiatt met radicalement l’accent sur les collaborateurs individuels et se distingue ainsi nettement des trois autres modèles de phases présentés. Mais c’est aussi le point central de la critique :
-
Le modèle ADKAR néglige l’importance de la dynamique de groupe.
-
Il néglige les aspects techniques et procéduraux des processus de gestion du changement.
-
Il fournit un cadre rigide pour un concept de gestion du changement, mais pas de modèle de mise en œuvre.
Mesures de gestion du changement : Quelle est la meilleure façon de procéder ? #
Chacun des modèles mentionnés ci-dessus part du principe que les différentes mesures de gestion du changement se déroulent de manière linéaire - en cela, ils ressemblent fortement au modèle en 7 phases de Streich déjà mentionné. Cependant, comme nous l’avons vu, cette structure linéaire donne une image biaisée. Certes, les modèles indiquent clairement quelles étapes sont importantes et peuvent donc être utiles comme cadre pour les stratégies de gestion du changement. Cependant, il est difficile de trouver des recommandations et des mesures réelles.

Comment procéder concrètement ?
-
Commencez par une analyse : Qu’est-ce qui doit être changé et quel est l’objectif ?
-
Identifiez les parties prenantes pertinentes avant de commencer toute action individuelle.
-
Créez la confiance par une communication ouverte.
-
Définissez clairement les rôles et les responsabilités.
-
Donner l’exemple d’une volonté de changement en collaboration avec la direction.
-
Mesurez en permanence les progrès afin de pouvoir réagir à temps en cas de problème.
Gestion du changement et gestion de projet #
Si vous voyez des parallèles avec la gestion de projet, ce n’est pas une coïncidence. En effet, la gestion du changement et la gestion de projet sont étroitement liées. Par exemple, alors que dans un projet informatique, le chef de projet est chargé de l’introduction technique d’un nouveau logiciel, la gestion du changement dans l’informatique consiste à impliquer les employés et à s’assurer que le nouveau logiciel est adopté et utilisé. Ainsi, les méthodes de gestion de projet sont généralement aussi des méthodes utiles dans la gestion du changement.
Analyse des parties prenantes #
L’analyse des parties prenantes vous permet de connaître les parties prenantes et leur intérêt pour votre projet.
Comment effectuer une analyse des parties prenantes ?
-
Identification : qui pourrait être affecté par votre projet ? Prenez également en compte les personnes extérieures à votre entreprise.
-
Hiérarchisation : toutes les parties prenantes ne sont pas affectées de la même manière par les changements. Classez vos parties prenantes par ordre d’intérêt et d’engagement - cela facilitera également la gestion ultérieure des parties prenantes.
-
Carte des parties prenantes : Classez maintenant vos parties prenantes en fonction de différents facteurs, par exemple les clients, les employés, les externes et la direction.
Cartographie de la culture #
La culture d’entreprise est influencée, entre autres, par le comportement quotidien des employés entre eux ainsi que par les valeurs et les normes que la direction vit et impose. Elle a parfois plus ou moins d’influence sur le succès des mesures de gestion du changement. Une carte de la culture vous permet d’obtenir des informations importantes afin d’identifier en amont les éventuels écueils.
Comment fonctionne la cartographie culturelle ?
Commencez par identifier différentes sous-cultures au sein de votre entreprise, par exemple des départements ou des divisions. Identifiez ensuite des groupes de cinq ou six personnes qui représentent le mieux ces différentes cultures et discutez avec eux. A partir des informations ainsi obtenues sur les blocages potentiels et les opportunités, créez votre carte culturelle. Le mieux est de travailler avec un outil de tableau blanc ou des diagrammes, par exemple un diagramme de dispersion ou une carte en arbre, et d’intégrer les informations ainsi obtenues dans votre planification de gestion du changement.
Carte de processus #
La carte de processus vous permet de visualiser différents processus, souvent sous la forme d’un diagramme de flux. Cela permet aux personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le processus de gestion du changement d’avoir une bonne vue d’ensemble et des informations importantes. En particulier, ces diagrammes vous aident à faire le point sur votre planification de la gestion du changement.
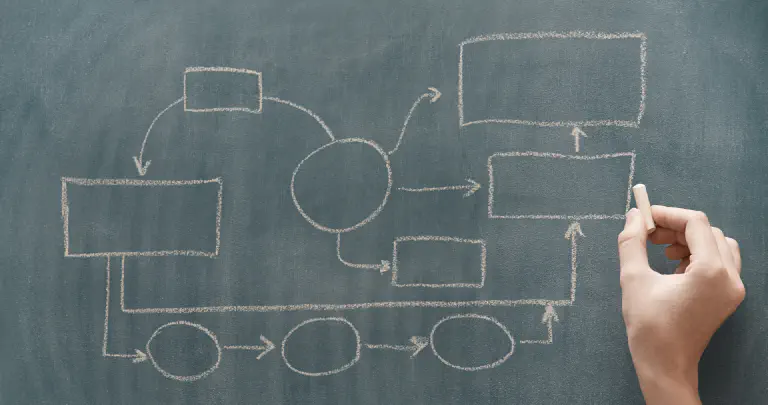
Analyse du champ de force #
L’analyse du champ de force de Kurt Lewin vous permet d’examiner les forces ou les facteurs en faveur ou en défaveur d’un changement ou d’une proposition. Elle est également appelée analyse des obstacles et des ressources et ressemble à une analyse SWOT .
Comment fonctionne l’analyse des champs de force ?
-
Définition du plan : Quel est votre objectif ?
-
Déterminer les aides : Quelles sont les forces (internes et externes) qui peuvent vous aider ?
-
Identifier les obstacles : Quelles sont les forces (même potentielles) qui s’opposent au changement ?
-
Pondérer : Quantifiez l’influence attendue de chaque force par un score.
Risques dans la gestion du changement #
Les projets de changement échouent souvent en raison d’un manque d’acceptation, d’une communication peu claire ou d’un manque de ressources. L’absence d’objectifs de gestion du changement ou des objectifs irréalistes sont également des causes fréquentes. Cependant, il est très rare que ces projets échouent à cause des employés, même si ceux-ci sont alors accusés d’être incapables ou de ne pas vouloir s’engager dans la nouveauté. En règle générale, les employés reconnaissent simplement très rapidement si le changement est dans votre intérêt ou non. Vous devez donc prendre en compte les intérêts de vos employés dès le début. Créez un plan de gestion du changement minutieux et transparent afin d’être bien préparé aux risques potentiels, tout en prévoyant suffisamment de temps pour une mise en œuvre durable - cette étape peut prendre plusieurs mois, voire plus.
Quel est le lien entre la gestion du changement et la numérisation ? #
Une bonne planification, des analyses, une communication régulière et transparente, la gestion des parties prenantes : sans l’outil adéquat, il est difficile d’accomplir ces tâches efficacement. Et tout comme une numérisation réussie nécessite un concept de gestion du changement bien pensé, la numérisation est à son tour une condition préalable à la réussite des processus de changement. Les nouvelles technologies telles que les solutions cloud, les plates-formes sans code, l’intelligence artificielle et les outils d’automatisation peuvent faire la différence et déterminer le succès ou l’échec de votre projet. Le critère le plus important est celui de vos besoins spécifiques : Choisissez un outil qui correspond le mieux à vos attentes et qui est évolutif. Sinon, vous risquez de passer d’un logiciel à l’autre ou de travailler avec différents outils, ce qui ne fera que compliquer inutilement vos mesures de gestion du changement.
SeaTable comme outil de gestion du changement #
SeaTable est un outil de base de données sans code moderne que vous pouvez adapter de manière flexible aux besoins de votre entreprise ou de votre projet. Spécialement conçue pour les mesures de gestion du changement, cette solution offre une variété de fonctions qui vous permettent de couvrir facilement d’autres processus. Grâce à l’interface utilisateur intuitive et aux nombreuses possibilités de personnalisation, les nouveaux utilisateurs prennent rapidement leurs marques sans avoir besoin d’une formation ou d’une longue mise en œuvre.
Une collaboration transparente en temps réel, des fonctions intégrées de chat et de notification, une gestion commune des données et des automatisations vous aident à atteindre les étapes clés de votre gestion du changement. Utilisez par exemple notre modèle gratuit d’analyse SWOT pour votre analyse du champ de force ou notre organigramme de projet pour votre planification de la gestion du changement.
Faites défiler notre modèle interactif d’analyse SWOT comme exemple pour votre analyse du champ de force.
Faites défiler notre modèle d’organigramme de projet interactif comme exemple de planification de la gestion du changement.
Des tableaux de bord et des statistiques personnalisables vous permettent de vérifier les progrès du projet à intervalles réguliers. Avec le App Builder, vous concevez en quelques minutes un front-end convivial pour vos parties prenantes, tandis que les plugins Whiteboard et Tree vous permettent de garder une vue complète de votre gestion du changement.
En tant que solution cloud , SeaTable est hébergé exclusivement sur des serveurs situés en Allemagne et est entièrement conforme au RGPD. Pour un contrôle encore plus grand de vos données, vous pouvez utiliser SeaTable Server pour héberger le logiciel sur vos propres serveurs. Dans la version de base gratuite, vous disposez de nombreuses fonctionnalités de base.
Conclusion #
Une gestion active du changement est un facteur de réussite décisif pour les entreprises afin de relever les défis actuels. La mise en œuvre efficace repose sur un concept clair, l’implication des collaborateurs, les bonnes méthodes de gestion du changement, une gestion empathique des émotions - et l’utilisation des outils adéquats.
FAQ - Planification de la gestion du changement #
Quels sont les plus grands facteurs de réussite dans les processus de gestion du changement ?
La réussite de la gestion du changement dépend en grande partie de trois facteurs :
-
Une définition claire des objectifs
-
Implication des dirigeants
-
Communication claire et transparence
Comment augmenter la volonté de changement des employés dans le processus de gestion du changement ?
Quels sont les principaux écueils de la gestion du changement ?
Les principaux risques auxquels vous pouvez faire face grâce à des méthodes ciblées de gestion du changement sont les suivants :
-
Définition peu claire des objectifs ou manque d’implication stratégique
-
Résistance due à un manque de compréhension ou à une crainte de perte de contrôle
-
Manque de ressources
-
surcharge de travail due à trop d’actions simultanées
Vous pouvez éviter les risques dès la planification de la gestion du changement grâce à une analyse des risques précoce, une communication transparente et une définition claire des objectifs de gestion du changement.
TAGS: Opérations